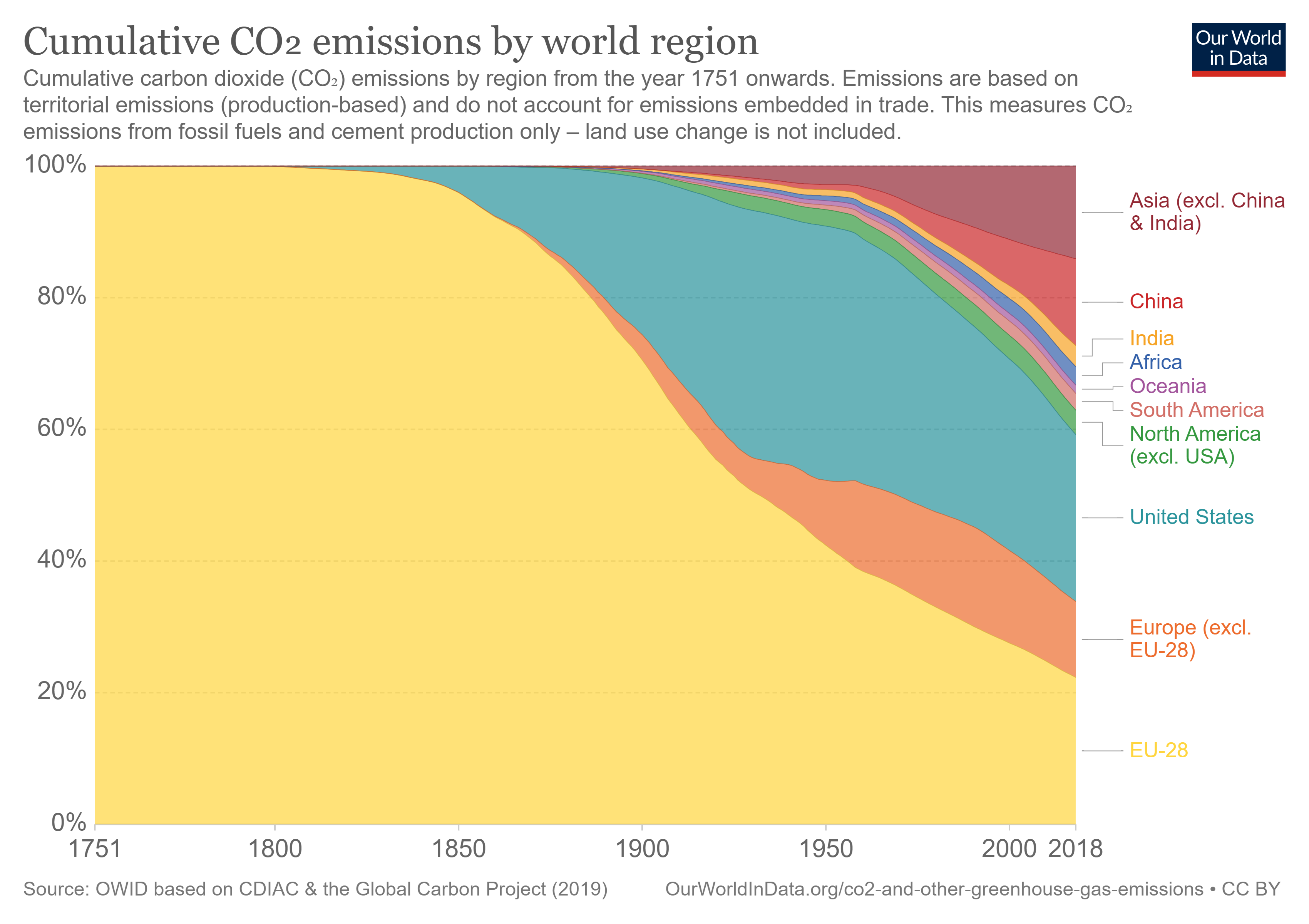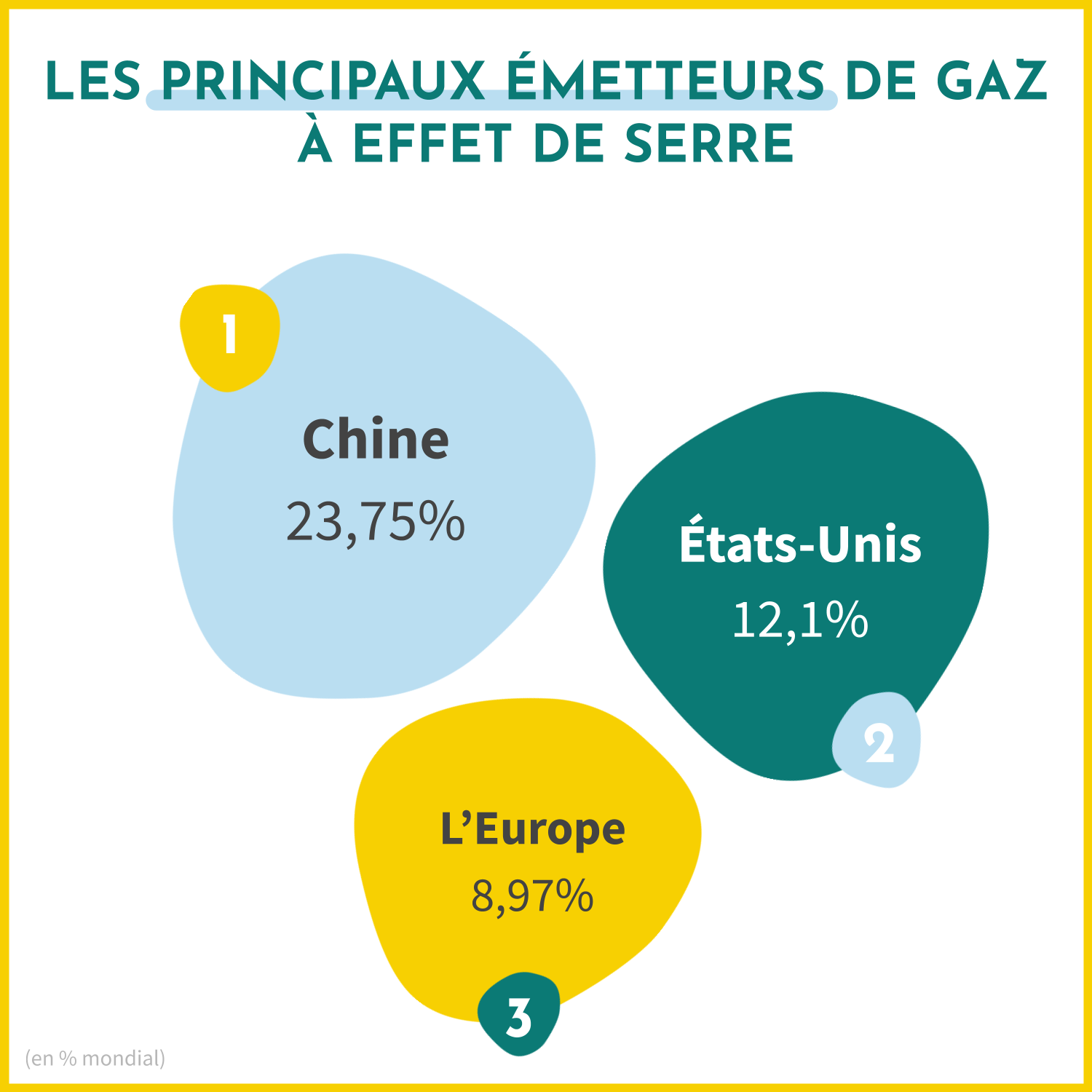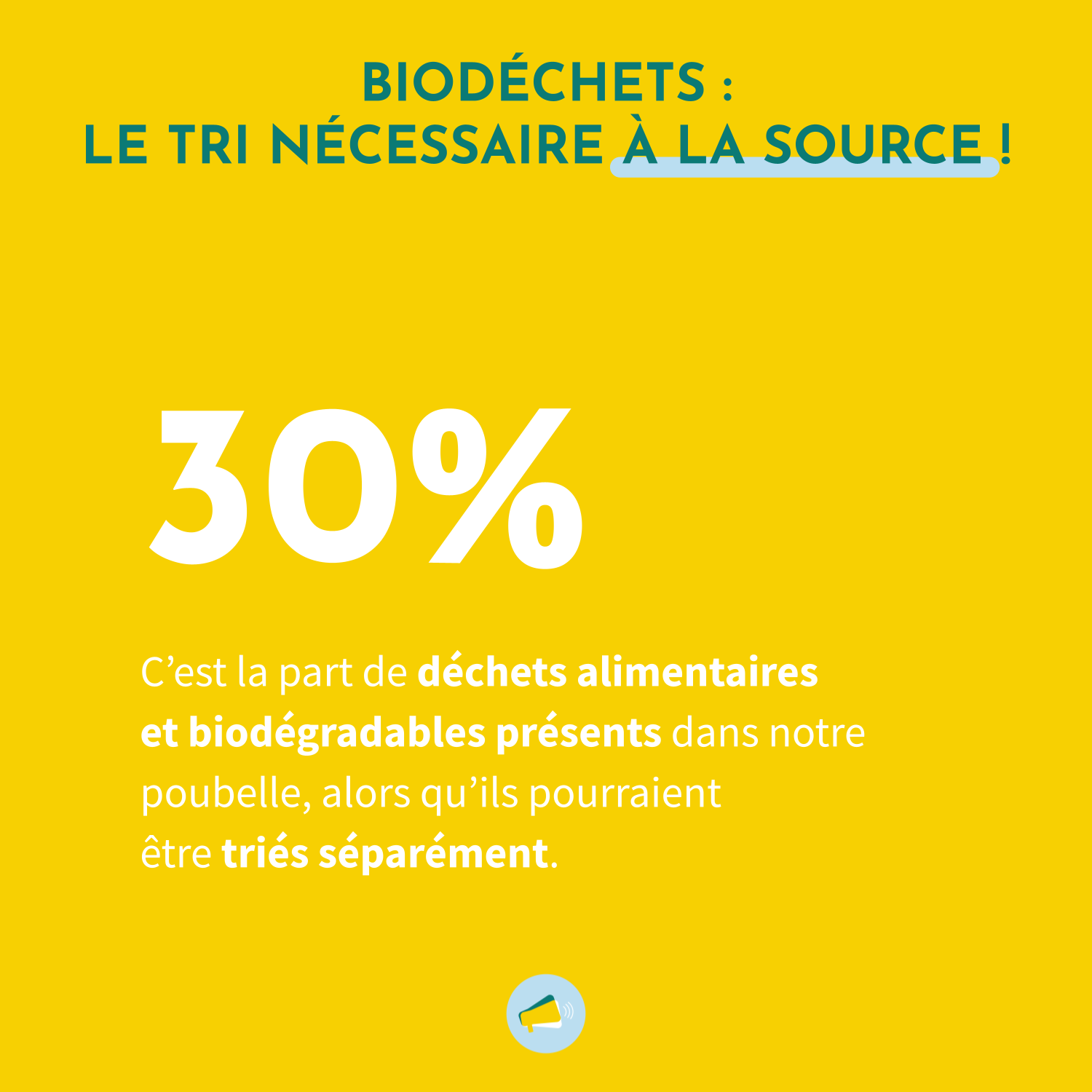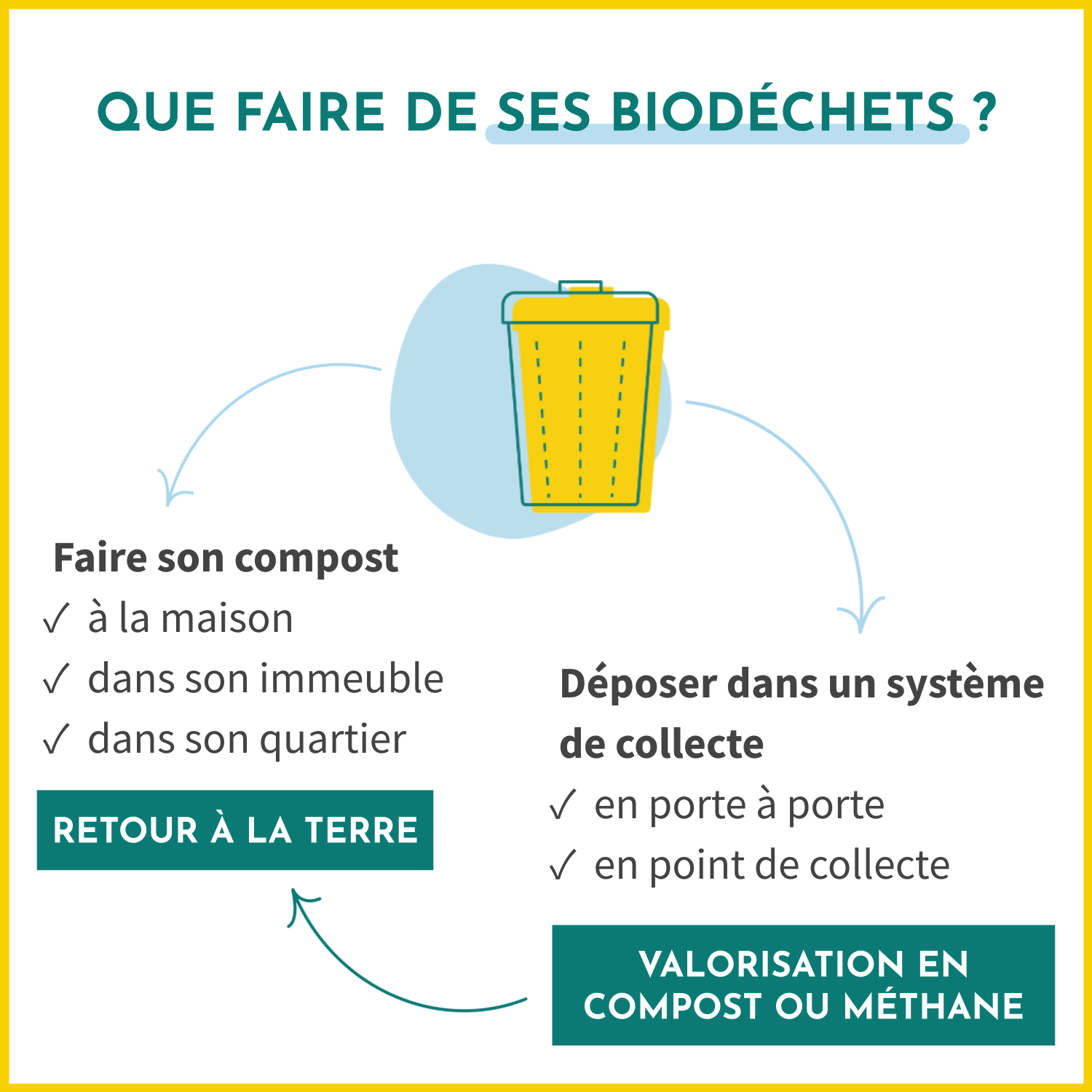Parti Pris, c’est un espace libre. Chaque article est une prise de position de la personne qui le rédige, qu’elle soit membre de Parti Civil ou invitée.
L’été dernier, en Californie, une des régions les plus riches du globe, des black-out ont privé des centaines de milliers d’américains d’un service de première nécessité. Ce raté soulève plusieurs problématiques, dont une commune à tous réseaux électriques : la pilotabilité du réseau, c’est à dire notre capacité à faire varier la quantité d’électricité sur le réseau à un moment donné pour correspondre à la demande. Quand on parle du développement des sources d’énergie renouvelable, l’aspect non-pilotable de la plupart de ces sources ressort comme un des enjeux majeurs de leur essor. Pour pallier ce problème, la solution du stockage de l’électricité est souvent mentionnée, avec la mention d’utilisation de technologies complexes comme les batteries ou l’hydrogène (On en avait même fait un article ici !). Ces technologies reposent sur des promesses d’innovation pour être fonctionnelles et viables à grande échelle. Cependant, est rarement évoqué le système de stockage éprouvé depuis plus d’un siècle, nommé STEP.
Une step, c’est quoi ?
Acronyme de Station de Transfert d’Energie par Pompage, une STEP est une centrale hydro-électrique spécifique, capable de faire monter de l’eau d’un bassin inférieur vers un autre situé plus en altitude pour stocker son énergie potentielle.
Pour comprendre le fonctionnement de cette technologie, quelques rappels sur l’hydroélectricité s’imposent. Les centrales hydroélectriques sont des usines munies d’une turbine, que l’eau sous pression provenant d’un court d’eau fait tourner. L’énergie de la pression de l’eau se transforme en électricité grâce à un alternateur lié à cette turbine. Les centrales peuvent être de deux sortes :
- Avec retenue. Un barrage retient ici l’eau pour former un stock et utiliser ce stock lorsque nécessaire. C’est donc une énergie pilotable.
- Au fil de l’eau. Pas de barrage ici, une partie du courant est simplement déviée dans la centrale, en fonction du débit du cours d’eau et sans stock possible, c’est donc une énergie non-pilotable.
Les STEP font partie de la première catégorie de centrale. Leur particularité est que la turbine, la partie mécanique de la centrale qui convertit la pression de l’eau en électricité, peut devenir en quelques minutes une pompe. Aux heures de faible consommation sur le réseau, le trop plein d’électricité est utilisé afin de déplacer l’eau de son bassin inférieur vers son bassin supérieur.Cela permet de stocker l’énergie qui, autrement, aurait été perdue. À l’inverse, aux heures de forte consommation, l’eau descend du niveau supérieur vers le niveau inférieur et actionne une turbine : c’est le turbinage qui permet de produire de l’électricité (comme dans une centrale hydro classique). La capacité de stockage est déterminée par la taille des bassins, et par différence d’altitude entre les deux bassins. Plus le dénivelé est grand, plus l’énergie stockée par litre d’eau déplacée l’est aussi.
Pas de procédé industriel complexe, pas de mine de cobalt et de lithium dans les pays émergents. Avec un rendement énergétique supérieur aux autres technologies de stockage (>75% contre 25% pour l’hydrogène et 70% pour les batteries[1]), les STEP ont un potentiel réalisable énorme en Europe (14 pays étudiés[2]), 10 fois supérieur au gisement exploité en 2013. Bien que le potentiel gisement soit énorme, il n’en reste pas moins que les STEP sont dès aujourd’hui un outil majeur de stabilité du réseau. En 2020, 99,2% de la puissance de stockage installée sur le réseau Français était hydraulique[3]. L’énergie produite dans ces centrales correspond à environ 5% de toute la production hydro-électrique Française[4], et contribue à la stabilité du réseau en période de forte demande comme cet hiver.
Futur des STEP
Malgré le rôle stratégique de STEP dans la stabilité du réseau électrique, la stratégie des différents pays Européens sur ce sujet diverge.
L’Allemagne était en 2019 le pays européen le plus fourni en STEP. Cependant, avec un gisement 20 fois supérieur à son potentiel exploité[1], l’Allemagne a décidé de ne plus investir dans cette technologie, ni même dans l’hydro-électricité au sens large. Elle mise maintenant sur la croissance des batteries et de l’hydrogène comme solution de stabilité du réseau.
À l’inverse, l’Espagne qui possède un gisement 10 fois plus grand qu’en Allemagne, a choisi d’investir massivement dans les STEP. La politique d’É tat prévoit de doubler sa puissance installée dans les 10 prochaines années, alors que ce pays est déjà le deuxième dans la liste des pays les plus producteurs d’électricité issue des STEP.
La France, elle, n’envisage pas d’augmenter sa capacité de stockage mais plutôt d’utiliser l’effacement, c’est-à-dire l’utilisation de moyens de production pilotables comme le nucléaire ou le gaz, pour maintenir un réseau stable.
Cependant cette logique n’est pas applicable aux régions qu’on appelle Zones Non-Interconnectées (ZNI), comme les îles par exemple. Ces zones ne peuvent pas bénéficier de l’électricité produite par une centrale nucléaire en métropole, et le gaz y est difficilement transportable. Traditionnellement leur mix électrique est donc fortement composé de pétrole, très polluant. Pour les ZNI, le meilleur moyen de conserver un réseau stable tout en diminuant les émissions de gaz à effet de serre du réseau est donc de développer le stockage local.
Depuis 2014 dans la plus petite île des canaries, el Hierro, un système hybride Eolien-STEP a été mis en place pour subvenir aux besoins de ses 10 000 habitants et des 60 000 touristes annuels de l’île. Ce modèle est à la fois bon d’un point de vue environnemental, et pourrait permettre aux ZNI, historiquement très dépendantes du prix du pétrole, d’accéder à une plus grande autonomie financière.
Limites des STEP
À la lumière des avantages que présente cette technologie face au défi climatique, il convient de s’interroger : Pourquoi les politiques, investisseurs et médias ne semblent pas ou peu intéressés par les STEP ?
Il existe plusieurs raisons à cela :
La petite hydro n’intéresse pas le secteur public
Tout d’abord, il existe dans l’hydro-électricité une division importante entre la petite et la grande hydro-électricité. L’État français a historiquement énormément investi dans la grande hydro, laissant les plus petites centrales de moins de 10 MW à l’investissement privé. Cette décision, probablement due à des questions d’économies d’échelle dans la gestion des centrales, est exacerbée sur la technologie STEP. Il n’existe en France que 6 grosses centrales STEP, toutes propriété d’EDF. Pour les centrales de cette taille, il n’existe plus de gisement non-exploité en France, ce qui limite l’intérêt d’EDF pour cette technologie.
Le modèle économique des STEP n’est pas assez rentable (pour l’instant)
Pour les petites STEP, on pourrait donc s’attendre à ce que des investisseurs privés aient un rôle dans leur développement, comme ils ont pu l’avoir pour les petites centrales hydro-électriques standards. Se pose alors le problème majeur des STEP, à savoir leur modèle économique. Les actifs hydro-électriques sont globalement très demandant en investissement initial, et possèdent une durée de vie extrêmement longue (>100 ans). Cependant, leur taux de retour sur investissement est faible, autour de 4% en France. Cela signifie qu’un investissement est rentable à partir de 25 ans, un horizon de temps très long pour les modèles d’investissement actuels.
Cet horizon temporel lointain de retour sur investissement s’applique également aux STEP, qui ne produisent pas d’énergie à proprement parler. Comme tout outil de stockage, elles créent de la valeur économique grâce aux différences en temps réel du prix de l’électricité, dit prix SPOT. Ces centrales achètent de l’électricité à bas coût en heures creuses, et la revendent en heures de pointe à une valeur plus élevée. La forte proportion du nucléaire dans le mix électrique français par rapport aux énergies non-pilotables permettant une volatilité faible de ce prix SPOT, la rentabilité de ce mécanisme en est donc affectée.
La croissance de la part de solaire et d’éolien dans le mix électrique pourrait accentuer cette volatilité, et rendre ce type d’actif plus rentable.
Les investissements sur temps long demandent de la confiance
Nous l’avons évoqué plus tôt, les actifs hydro-électriques sont des investissements rentables sur le long terme. Les investisseurs qui placent leur argent dans ce type d’actifs doivent donc avoir confiance en la rentabilité de leur investissement. Celle-ci ne doit pas s’écrouler du jour au lendemain, du fait notamment d’un changement de politique publique.
Or, les politiques publiques concernant l’énergie évoluent, selon le bord politique du Gouvernement en place. La programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE), qui définit la feuille de route énergétique du pays, est modifiée tous les 5 ans. Pire, elle n’est qu’indicative d’une stratégie et en aucun cas contractuellement engageante pour des investisseurs qui voudraient anticiper les changements à venir du mix électrique. Il est donc trop risqué pour les investisseurs de parier sur un investissement d’une telle ampleur temporelle, qui miserait sur l’augmentation des énergies renouvelables sur les 20 prochaines années.
Limites de stockage
Le stockage d’électricité de manière générale est très utile pour pallier les différences entre les pics et les creux de demande au cours d’une journée, voire d’une semaine. Cependant, pour des variations saisonnières fortes, aucun système de stockage ne saurait suffire à compenser les différences à la fois d’offre et de demande.
La demande, tout d’abord, est dépendante de la saison, et compenser une augmentation de 20% de la consommation électrique Française entre un jour d’hiver et un jour d’été demanderait 263 GWh soit 1,4 fois la quantité d’énergie stockée par les STEP françaises à leur plein.
Si le stockage est utile et nécessaire à la stabilité du réseau, il ne sera peut-être pas suffisant dans un monde 100% renouvelable.
Acceptation des projets
L’introduction de nouveaux projets hydrauliques, qui plus est avec barrage, rencontre aussi des difficultés d’acceptation des populations et de l’administration. Deux raisons à cela : l’altération du paysage visuel et sonore et l’impact écologique. En effet, comme tout actif énergétique, les STEP ne sont pas sans conséquences sur leur environnement. La création de lacs artificiels en amont et en aval de la centrale provoque des inondations qui modifient les habitats naturels de la faune locale.
L’abandon des énergies fossiles est nécessaire à une transition énergétique aboutie. Pour ce faire, toutes les pistes pour augmenter la capacité de stockage doivent être poursuivies pour compenser l’intermittence de l’éolien et du solaire. L’hydraulique a son rôle à jouer dans ce contexte, et pour lui donner la place qu’il mérite un changement devra s’opérer, soit dans la planification des investissements et les horizons de temps considérés pour celle-ci, soit dans les méthodes de rémunération de l’électricité.
PAR BARTHÉLÉMY MARAVAL
Notes et sources
1. Xxx
2. Xxx